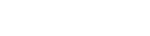Entretien avec Marcelline Delbecq
Léa Bosshard : J’amorce notre entretien avec la notion de témoin depuis laquelle nous avons souhaitons t’inviter à participer à cette recherche. Voici la définition qu’en donne Rémy : « “Le latin a deux termes pour désigner le témoin. Le premier, testis, dont vient notre « témoin », signifie à l’origine celui qui se pose en tiers entre deux parties (terstis) dans un procès ou un litige. Le second, superstes, désigne celui qui a vécu quelque chose, a traversé de bout en bout un événement et peut donc en témoigner” [1]. Le témoin dans mon travail est l’incarnation, la condensation de ces deux définitions. Á ces deux définitions il faut également ajouter celle du contrepoint en composition. Le témoin serait donc a minima l’incarnation de la figure du contrepoint ». Comment comprends-tu à ton tour ce témoin ?
Marcelline Delbecq : C’est intéressant que ce projet me donne pour la première fois l’occasion de réfléchir à la notion de témoin sur laquelle je ne me suis jamais véritablement penchée en tant que telle alors qu’elle est, me semble-t-il, au cœur de l’acte photographique et de sa réception sur lesquels en revanche je réfléchis depuis un certain temps. J’aimerais développer deux axes, dont je ne suis pas encore certaine qu’ils soient cohérents entre eux, ni légitimes (il s’agit plutôt d’une intuition) : interroger la figure de témoin qui n’aurait pas vu/entendu/vécu un événement (cette notion existe en justice, il s’agit d’un témoin qui rend compte d’une expérience qu’il s’est appropriée par ouïe dire), en l’associant à la question « Peut-on être témoin de ce que l’on n’a pas vu ? ». Auxquelles s’ajoutent les notions de témoin de l’ordinaire, et de témoin sans conscience de l’être. Par exemple, à chaque instant, nous sommes témoins de quelque chose : une feuille qui s’envole, un pied qui se tord, un avion qui laisse une trace dans le ciel, un éternuement. Pour autant, nous n’enregistrons pas ces informations comme étant d’importance, non seulement parce qu’à priori elles n’en sont effectivement pas (ou en tout cas elles n’ont pas de prise directe sur notre propre existence), mais aussi parce que ces actions dont nous sommes les témoins ne produisent rien qui soit digne d’être relevé : ni liesse ni drame. Il va de soi que si nous devions enregistrer comme
« évènementielles » les moindres choses dont nous sommes les témoins directs au quotidien, nous serions submergés de faits, d’images, d’actions sans que pour autant elles produisent de réaction ou de pensée a posteriori. Or, quelle que soit sa situation, un témoin est un passeur : une personne qui fait le lien entre un événement notable et sa pérennité. Le témoin est celle ou celui qui est en mesure de faire exister à nouveau, par ses paroles, ses gestes, une situation que les gens qui s’adressent à elle ou lui n’ont en général pas partagée. Le témoin, quand il est amené à s’exprimer, a donc une forme de responsabilité de transmission. Quid de celle d’un témoin qui n’aurait rien vécu ?
L.B. : Qu’est ce que cela convoque pour toi dans l’écriture et/ou dans l’image ?
M.D. : C’est un peu tôt pour en parler, car justement ce temps de travail va permettre de creuser de nombreux axes de réflexion de visu (en passant du temps sur le lieu du Stade Sadi-Carnot et dans ses environs), dans l’écrit (dans un aller-retour entre les notes prises sur place et les notes de lecture d’ouvrages liés au projet) et dans les images, celles qui seront produites à l’occasion comme celles qui existent déjà. Il est en effet question de travailler à partir des archives de Pantin et ainsi de remonter à un passé dont le lieu lui-même ne porte plus de trace. Je ne sais évidemment pas bien encore ce qui va naître de tout cela (une lecture ? Une publication ? Un film ?) mais ce sera une très bonne occasion d’expérimenter entre la réalité du lieu et l’écriture d’une forme d’histoire qui lui soit afférente.
Ces derniers temps, j’ai lu un certain nombre de textes sur la notion de témoin et il y est en majorité question de la Shoah. C’est incontournable, cela va de soi. La Shoah est un moment de l’Histoire tellement inconcevable en pensée que les témoignages sont cruciaux. Tout avait été pourtant mis en place pour annihiler la moindre trace. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit lors du génocide perpétré par les Allemands en Namibie à partir de 1904 [2]. C’était le préambule évident à ce qui serait mis en place en Europe quelques quarante ans plus tard, abomination qui a décimé dans le plus parfait silence deux peuples entiers en quatre ans (les Nama et les Héréro). Des centaines de milliers de morts dont personne n’a eu vent, exterminés d’abord à la mitrailleuse, ensuite selon une logique concentrationnaire réutilisée à l’encontre des déportés en Europe, juifs, homosexuels, tziganes, prisonniers de guerre. Une implacable logique d’extermination dont personne n’a parlé parce qu’elle a eu cours en Afrique. Les images, car il y en a eu, n’ont jamais circulé.
Il y a aussi le cas terrifiant des films mis en scène par les nazis dans les ghettos de Łódź, de Cracovie ou de Varsovie, dont l’historienne Sylvie Lindeperg parle très précisément dans un entretien avec Jean-Louis Comolli [3]. Goebbels avait donné l’ordre de tourner dans les ghettos pour « fixer » le peuple juif avant sa disparition. Constituer une archive de celles et ceux qui devaient être annihilés pour légitimer leur éradication (puisqu’ils n’étaient dignes que d’être comparés à de la vermine), tout en les faisant jouer des rôles mensongers, conformes aux visions antisémites. C’est un cas extrême d’objet : une archive mensongère qui ne témoigne que de l’horreur qu’elle fait semblant de dissimuler.
La question de la valeur de témoignage d’un témoin ou d’une image continue de faire débat, car entre la parole du témoin et le silence de l’image, l’équilibre est parfois très fragile. L’image peut témoigner mais ne donne qu’une infime partie de la réalité factuelle. Elle montre autant qu’elle donne à interpréter. Les photographies et les films sont enregistrés par une machine dont un être humain est l’opérateur, choisissant son cadre, même si par défaut. Les témoins, quant à eux, ont la fragilité de l’humain sans machine : on peut mélanger souvenirs et reconstitutions, oublier aussi. La chimie du cerveau et de l’organisme entier peut produire des réactions intervenant sur la remémoration. C’est d’ailleurs pour cela qu’une équipe d’historiens a mis en place un suivi des témoins du 13 novembre 2015 [4] pour les dix prochaines années : parce que l’on sait que le témoignage se modifie, s’altère ou s’enjolive avec le temps, auquel s’additionne tout ce qui est lu, entendu et vécu par le témoin qui demeure en vie. Cet
« observatoire », qui engage aussi des psychologues et des neurologues, a été pensé parce que les spécialistes se sont justement rendu compte que certains témoignages de la Shoah avaient été recueillis trop longtemps après les faits. Parce qu’on ne voulait pas savoir, mais aussi parce que certains témoins étaient incapables de mettre en mots. Et que lorsque dites, ces paroles étaient particulièrement difficiles à écouter. À la libération des camps, les anglo-saxons qui ont filmé n’ont pas cru ce qu’ils voyaient. Le réalisateur Samuel Fuller, qui n’a développé qu’en 1986 le film qu’il avait tourné à Falkenau en 1945, images qu’il commente dans le film Falkenau, vision de l'impossible d’Emil Weiss, raconte : « Je ne pouvais pas voir mon film car il est cette nuit en Tchécoslovaquie, la fin de toute cette guerre, c’est l’Impossible. Pas l’Incroyable, ni l’Horrifiant, mais un mot simple, que tout le monde peut comprendre, un seul mot. La chose importante, c’est que l’Impossible nous choquait, mais pas au sens où l’on utilise le mot “choc”. C’est plus fort que de rendre malade ou d’horrifier. C’est hypnotiser. Et le silence parmi nos soldats était très lourd, quatre ou cinq jours durant, on a gardé le silence ». Il n’avait pas développé son film pour éviter de se confronter à la réalité de ce qu’il avait vu en le filmant, pour ne pas faire face à une réalité enregistrée par lui-même et dont il ne parvenait à se détacher, témoin pourtant impuissant.
Il y a deux ans, le Musée d’Orsay m’a demandé d’écrire un texte à partir des photographies de l’exposition Qui a peur des femmes photographes 1839-1945. Ce texte existe, il s’appelle À la dérobée et a été écrit à partir de documents (photographies et films) réalisés par des femmes à travers l’histoire (de l’Angleterre victorienne au présent). J’avais, entre autres, sélectionné une photographie absolument bouleversante d’une femme, photographiée par une autre femme dans le camp de Ravensbrück en octobre 1944, relevant son manteau dans un geste bref pour montrer des cicatrices sur ses jambes [5]. Elle était cobaye d’un chirurgien nazi qui pratiquait sur les « lapins » (leur surnom) des expériences pseudo-médicales. Le fait que cette femme montre à une autre, clandestinement, ce qui se perpétrait à travers elle, et qu’un sourire grimaçant accompagne ce geste comme pour dire « regarde, et montre ce que tu as vu » m’a rendue muette. L’abomination de cette situation furtive pourtant capturée par la photographe et donnée à voir pour la postérité (c’est l’ethnologue Germaine Tillion, internée à Ravensbrück, qui a porté autour du cou dans un petit sac en laine la pellicule, pendant des mois) m’ont totalement empêchée d’écrire quoique ce soit à partir de cette photographie. La photographe me rendait témoin d’une situation dans laquelle j’aurais sans doute été de la plus grande impuissance si je l’avais vécue. Cette photographie parlait d’elle-même, aucun mot de ma part ne pouvait y apporter quoique ce soit. J’ai fini par ne plus pouvoir la regarder tant mon impuissance à lui rendre justice était flagrante. J’avais honte d’en être le témoin a posteriori, même si reconnaissante à la photographe d’avoir pris ce risque pour que celles et ceux qui verraient cette image comprennent qu’une telle chose ait pu exister. Cette image est aussi née d’une force de résistance incroyable : ces femmes savaient que si les images leur survivaient, elles agiraient en tant que témoins.
Ce rapport inévitable de la question du témoignage à la Shoah m’obligera aussi à étudier des textes dont j’ai toujours reculé la lecture (Charlotte Delbo, Primo Levi, Robert Anthelme, Giorgio Agamben), parce que justement l’écrit contient en lui une formidable capacité à imprimer l’effroi durablement en soi. Je n’ai jamais pu terminer La Nuit d’Elie Wiesel car je revivais en cauchemars ce qu’il y décrit. Ce qui est cependant intéressant avec l’écrit, c’est que l’on choisit de le lire, on choisit de continuer ou d’en stopper la lecture. Une image, en revanche, a quelque chose de bien plus abrupt, et donc une violence immédiate : on peut tomber sur une photographie par hasard et une fois vue, on a beau détourner la tête de l’écran, dissimuler ses yeux ou fermer le livre ou le journal dans lequel elle est imprimée, on ne peut plus l’effacer, elle se loge quelque part dont on voudrait la déloger, mais sans succès. Seul le temps y fait, s’il y parvient. C’est ce que Susan Sontag a souvent raconté, ce basculement qui s'est opéré en elle à la vue de photographies des camps nazis dans une librairie de Santa Monica en 1945. Elle avait douze ans et n'avait entendu parler de rien. Elle raconte cette sidération à la vue d'images qu'elle-même n'aurait jamais pu imaginer et encore moins songer être réelles, images dont elle comprend instantanément la charge mais dont le mutisme la laisse dans l'inconnu de ce qui en est l'origine. On voit à quel point la Shoah habite cette notion de témoin, et si j’ai déjà abordé la question à distance dans certains textes (… poudre aux yeux, alibi notamment), je suis aussi très frileuse car une partie de ma famille a miraculeusement échappé à la déportation. D’où puis-je donc parler puisque mes proches ont été
épargnés ?
Dans une logique qui n’est pas sans lien, je m’intéresse aussi beaucoup aux témoignages sur Hiroshima, car les survivants au Japon ont vécu l’enfer d’avoir été victimes jusque dans leur survie. Le film Lumières d’été de Jean-Gabriel Périot commence par un extraordinaire témoignage d’une survivante face à un caméraman japonais installé en France. Cette scène dure presque une demi-heure : la femme âgée et très belle raconte, comme si cela venait de se passer, le moment où son existence a basculé. Je me suis posé la question de l’écriture du scénario, si cette femme est réellement une survivante ou si c’est une comédienne qui raconte le récit d’une survivante, ou si encore le cinéaste a écrit cette partie d’après ses lectures, ses rencontres. Ce que dans le film on prend de fait pour un témoignage réel peut en fait avoir plusieurs types d’implication ou de distance par rapport à l’événement lui-même (en l’occurrence, la femme filmée est une comédienne de mime). Dans son texte Hiroshima, l’écrivain britannique John Berger réagit à des dessins réalisés par des survivants un demi-siècle après le largage de la bombe atomique le 6 août 1945. Et c’est peut-être un exemple de la limite de celui qui n’a pas vu : à travers l’observation de ces dessins, Berger veut se faire l’écho d’un événement qu’il n’a pas vécu pour le dénoncer et en dénoncer d’éventuelles répliques. Or il n’a « rien vu » à Hiroshima. Certes, il ne prétend pas témoigner des faits et ce dont il se souvient est l’annonce de la nouvelle à des milliers de kilomètres de l’impact, alors qu’il était jeune soldat. L’axe central de son essai est de faire prendre conscience que le nucléaire est dévastateur car il l’a été dans sa plus extrême mesure à l’encontre du peuple japonais. C’est tout à son honneur mais cela pose aussi la question des limites de l’écrivain : si dans l’absolu on peut écrire sur tout, et ainsi se transformer en témoins, ou du moins en passeurs, d’évènements non vécus (du plus banal au plus tragique), d’où écrit-on ? Est-ce qu’un texte écrit par un occidental n’ayant jamais fait l’expérience d’une bombe atomique peut être aussi juste qu’un dessin de témoin ? Ou que la photographie d’une montre de la série de Shomei Tomatsu que l’on pouvait voir l’été dernier à la Maison Européenne de la Photographie et sur laquelle, hypnotisée moi aussi, j’ai écrit pour le magazine Art Press ?
(…) Montre déterrée à environ 0,7km de l'épicentre, 1961 de Shomei Tomatsu fait partie d’une série amorcée en 1961, soit une quinzaine d'années après le largage des bombes atomiques les 6 et 9 août 1945. La montre retrouvée si près de la déflagration de Nagasaki a été arrêtée par le souffle à l'heure précise où celle-ci a eu lieu, 11h02. Contrairement à la plupart des gens et des objets situés au même moment dans un rayon de plusieurs kilomètres, la montre n’a pas fondu. Mais la capture photographique semble l’arrêter une seconde fois, stoppant le compte des minutes mais pas le cours de l'histoire, marquant au fer blanc le flux continu d'un temps suspendu contenant en lui le chaos. Pourtant, cette montre devient aussi le symbole de tout un pays résolument tourné vers l’avenir en dépit d’une histoire régulièrement mise à mal. Et les photographes, dans leur intransigeance et leur engagement, veillent à perpétuer pour leurs pairs la mémoire et la lumière que toute photographie contient en elle [6].
On peut bien sûr se demander quelle légitimité m’a poussée à écrire sur un événement si distant ; Berger avait lui, au moins, vécu la contemporanéité de l’événement. Dans mon cas, j’ai eu l’impression d’écrire avant tout sur des images d’objets qui, photographiés bien après les faits, n’avaient rien perdu de leur force dévastatrice et continuaient, bien plus longtemps après, à mettre les spectateurs face à leur propre rôle de témoin d’une image. Effet tétanisant de ce qu’ont produit des faits « Impossibles », pour reprendre l’expression de Samuel Fuller.
Deux autres ouvrages qui me semblent importants dans leur lien avec la notion de témoin sont Testimony de Charles Reznikoff et La vie des hommes infâmes de Michel Foucault. Dans les deux cas, il s’agit de récits empruntés à ou écrits à partir d’archives judiciaires. Reznikoff prend le parti radical de s’en tenir à l’énonciation de faits tels qu’enregistrés par l’administration judiciaire aux Etats-Unis. Chaque affaire fait l’objet de quelques lignes, suffisantes pour transmettre la teneur de la situation sans réécriture et ainsi témoigner de l’état des souffrances des américains en proie à la justice. Dans son texte de 1977, Michel Foucault part lui aussi d’archives qu’il utilise comme base pour analyser la contradiction de la situation : s’ils n’avaient pas eu affaire à la justice, ces femmes et ces hommes condamnés seraient restés parfaitement anonymes. Mais leur menu larcin ou l’accusation portée à leur encontre les fait tout à coup devenir partie prenante de l’Histoire.
Mais revenons au contemporain, sur lequel il est, dans mon cas, beaucoup plus difficile d’écrire. Comme je le disais, l’idée d’aborder la question de témoin n’ayant pas vu est une première intuition, idée comme un fil rouge dont je saurai en travaillant si elle a lieu d’être. Cela m’a permis en tout cas, et grâce à Rémy qui venait de lire ce livre, de rencontrer Adrien Genoudet avec qui je vais travailler pendant cette résidence. Il se pourrait d’ailleurs que nous produisions une forme commune. Historien et cinéaste, Adrien Genoudet est aussi assistant de Patrick Boucheron au Collège de France, et a publié en septembre 2017 un livre très marquant intitulé L’étreinte. Dans ce texte assez inclassable que je vais malhabilement résumer, il écrit une sorte d’écho très personnel aux évènements du 13 novembre, évènements que nous avons pour la plupart vécus quasiment en direct et dans la plus grande sidération sans en avoir été témoins. Il parvient de manière virtuose à nous faire partager son témoignage de quelque chose qu’il n’a pas vécu, mais en tant que témoin dont l’écriture seule assure le témoignage : celui d’un état, d’un élan, qui conduisent l’auteur/narrateur dans une quête haletante entre présent immédiat et chemins de traverses historiques. Je me réjouis vraiment de collaboration et de travailler avec lui sur la réalité du stade, de ce lieu qui ne fait pas encore partie de notre histoire mais va le devenir, un lieu dont le présent, le passé et le futur vont nous donner matière à aborder cette passionnante notion de témoin. Ce sera l’occasion de mener une recherche très documentée car on peut difficilement écrire l’histoire d’un lieu sans le témoignage de celles et ceux qui le fréquentent ou l’ont fréquenté, de près ou de loin. Et cela n’empêche pas la fiction ou l’extrapolation.
L.B. : Me revient aussi en mémoire votre dialogue avec Ellie Ga où tu parles d’une vidéo d’émeute où la caméra devient témoin au-delà du caméraman, puis de la lune filmée en Syrie qui elle au contraire manifeste un témoignage immuable et qui ne dit rien d’autre qu’elle-même. Il y a là deux registres de témoin qui soulignent la charge politique contenue intrinsèquement, que l’on retrouve aussi dans la définition qu’en donne Agamben. Je trouvais intéressant de revenir sur ces exemples qui marquent les liens plus ou moins évidents entre la vue, l’évènement et le témoin qu’on aurait tendance à lier de façon intrinsèque.
M.D. : Je me permets de reprendre cette partie de Dialogue [7] dont tu parles, où j’évoque ces deux courtes vidéos montrées par l’historienne Cécile Boëx, historienne enseignante à l'EHESS spécialiste du monde arabe, lors du séminaire du Bal organisé par Bertrand Schefer, L’image événement intérieur, en octobre 2016 [8].
« (...) Ne pouvant plus se rendre en Syrie où elle a vécu et travaillé dix ans, elle (Cécile Boëx) concentre sa recherche sur ce qui est mis en ligne. Mais sur ce qui, justement, dans la masse d'images, de films et de documents mis à disposition de manière confuse, dans le fourbi d'une histoire contemporaine qui s'écrit au moment même où elle advient, ne montre presque rien ou si peu que personne ne prend le temps de regarder et de garder ces documents, personne ne les trouve suffisamment chargés pour être dignes de persister pour que l'histoire de l'histoire puisse s'écrire. Deux des exemples qu'elle a montrés et développés m'ont marquée au fer blanc. L'un est une vidéo, montée directement sur un téléphone, d'une pleine lune filmée depuis un balcon ou un toit, de loin d'abord puis zoomée. Je ne sais plus ce que dit la voix de celui qui filme, je crois qu'il donne la date en continuant à filmer la lune de ce soir-là. Or c'est justement parce que personne n'a sans doute pris le temps de regarder la lune dans le chaos, qu'elle devient dépositaire de ce qui est arrivé ce soir-là, à cet endroit-là. Elle seule sait, témoin infaillible depuis bien avant qu'il y ait des humains sur terre. Le deuxième film était celui d'un caméraman filmant une embuscade. On regarde avec le caméraman à travers son viseur, on voit ce qu'il voit, ce qu'il a vu. Puis on entend le claquement sec d'un tir et la caméra tombe à la renverse tout en continuant à filmer. Les voix autour s'agitent mais la caméra ne bouge plus, fait la morte à la verticale tout en continuant à filmer ce que le caméraman n'a jamais pu voir et que pourtant dans son malheur il nous montre. Plusieurs choses sont sidérantes dans cette séquence : le fait de continuer à voir à la place du caméraman, le fait d'assister à la rapidité d'une exécution triviale, le fait d'être soi-même le caméraman et de s'en sortir vivante. Si justement je me protège énormément des images des médias, celles-ci continuent de me donner à réfléchir parce que justement ce qu'il y avait à y voir allait bien au-delà de ce qui était vu ».
Je ne crois pas avoir besoin de revenir sur ce qui m’avait frappée dans ces vidéos, le texte le dit mieux que je ne pourrais le réécrire aujourd’hui. Par contre, ce qui est intéressant et que je réalise a posteriori et pour cet entretien, c’est que Cécile Boëx, historienne privée de son terrain d’étude, puisse trouver sur internet, dans les images fixes ou animées sans cesse mises en ligne, matière à continuer sa recherche. Ne pouvant pas être témoin direct sans que ce soit au péril de sa vie, elle utilise les témoignages d’ordres très différents de celles et ceux qui vivent les évènements et les retransmettent, pour à son tour pouvoir écrire, au fil de son déroulé, une histoire de la Syrie contemporaine en plein chaos. Et pour comprendre ce qui se passe en Syrie comme partout ailleurs, il faut aussi, me semble-t-il, des témoins d’une autre sorte, tenus à distance, capables d’analyser les faits sans les avoir forcément vécus. Je viens d’ailleurs de relire Passages de l’histoire de Dork Zabunyan, un formidable petit livre publié dans la collection Faux Raccord chez Le Gac Press, dans lequel il parle déjà, en 2012, de la difficulté à appréhender ces images amateurs mises en ligne, à penser leur appropriation par des cinéastes européens et leur devenir-archive pour une écriture de l’histoire à la fois désordonnée et essentielle.
1/- AGAMBEN Giorgio, Ce qui reste d’Auschwitz, Rivages Poche, Petite Bibliothèque, 2003, Paris, p 17.
2/- https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/expositi...
3/- Images d’archives : l’emboîtement des regards, entretien avec Sylvie Lindeperg, Images documentaires 63, 2008
4/- https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-hist...
5/- Catalogue de l’exposition Qui a peur des femmes photographes ? Musée d’Orsay et éditions Hazan, 2015, p. 255, illustration 276
6/- https://www.artpress.com/2017/07/20/memoire-et-lumiere-photographie-japo...
7/- Marcelline Delbecq et Ellie Ga, Dialogue, Shelter Press, 2017
8/- L’image, événement intérieur, les Carnets du Bal, décembre 2017